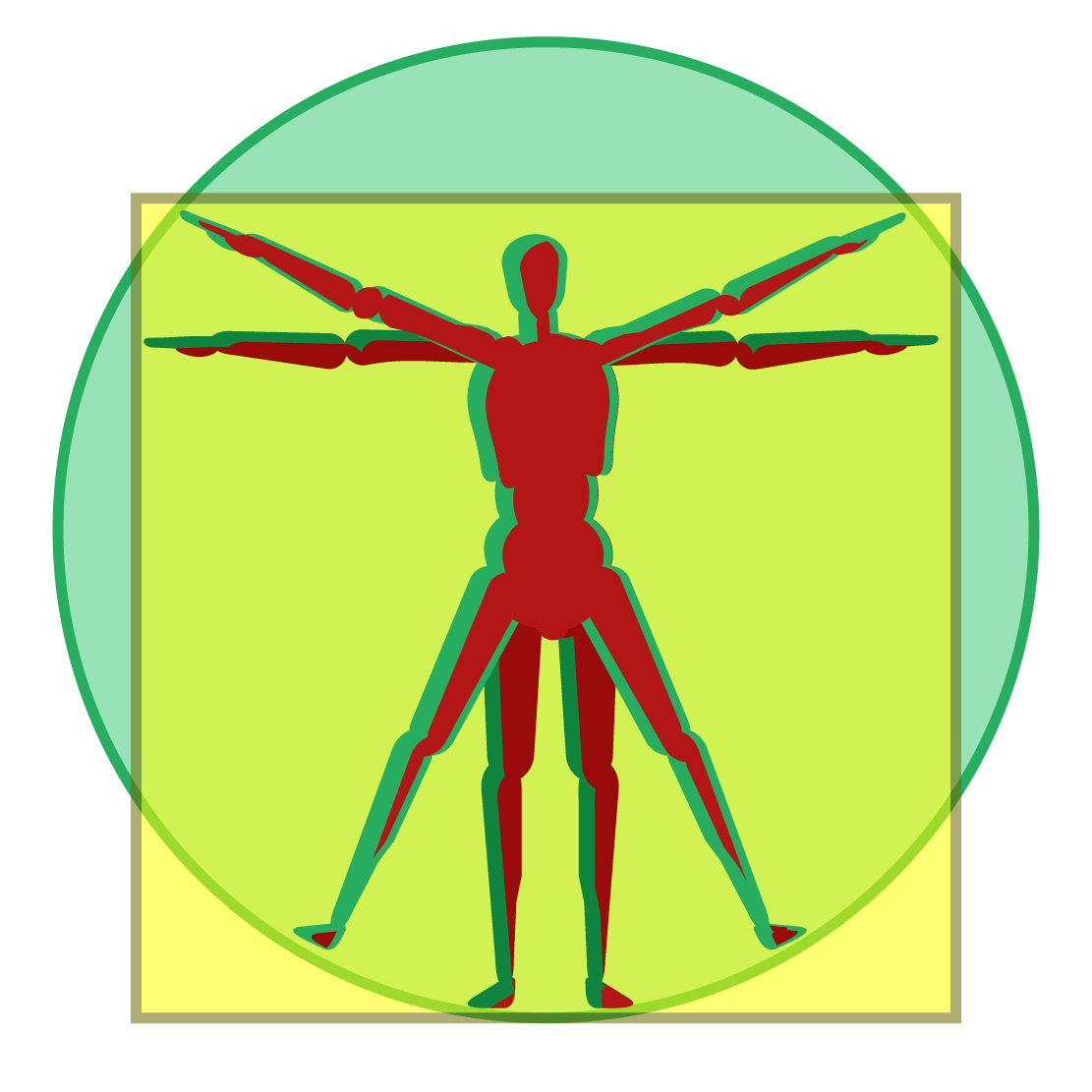
Le Non Savoir source de compétence par Thierry Tournebise
19 mars 2018 par Luci SogorbLe Non Savoir source de compétence par Thierry Tournebise
Pour ajouter à l’intellect la touche d’humanité manquante
L’ignorance a quelques lacunes
Sans le savoir, nous n’aurions pas la technologie, les moyens de transport modernes, les outils médiatiques… nous n’aurions pas non plus la médecine, la possibilité de vivre plus vieux en meilleure santé. Depuis la découverte du feu (au moins) jusqu’à aujourd’hui, l’homme a toujours été curieux, par plaisir ou par nécessité.
Le savoir et sa vulgarisation nous ont enrichi de façon inestimable. Réjouissons nous donc du fait que ceux qui savent continuent à savoir plus… et cela pour le plus grand bien de tous.
Afin que l’ego de l’humanité n’enfle tout de même pas trop je rappellerai tout de même les problèmes d’étiques posés par la science (et que la science à elle seule ne peut résoudre). Notons aussi cette définition que Louis Lerince-Ringuet, lui-même éminent savant, donnait de ses pairs : Un savant, c’est quelqu’un dont l’ignorance a quelques lacunes !
C’est avec malice qu’il nous indique que le savoir n’est qu’une petite lacune dans l’immensité de l’ignorance… même pour un savant. Ceci nous invite tout naturellement à la modestie.
Mais, paradoxalement, cette immensité d’ignorance contient un élément plutôt inattendu et relativement inexploré : c’est l’aptitude à ne pas savoir !
L’aptitude à « ne pas savoir »
Il semble naturel de constater que l’ignorance soit encore immense. Ce qui est surprenant, c’est que l’une des zones les plus rebelles au savoir soit justement l’aptitude à ne pas savoir.
Nous mesurons mal son importance car celle-ci semble négligeable. A quoi bon être capable de ne pas savoir dans ce monde de connaissances et de technologies ?
Au moins pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, l’esprit doit d’abord admettre qu’il n’est pas plein ! Celui qui pense tout savoir ne dispose plus d’aucune place dans son esprit pour une pensée nouvelle. Alors il ne peut plus rien apprendre, il se sclérose et stoppe son évolution.
Sans l’aptitude à ne pas savoir, nous sommes atteints de cécité intellectuelle. Nous sommes amenés à deviner le monde qui nous entoure exclusivement à partir de celui qui nous habite. L’esprit devient alors comme une taupe voyageant dans ses galeries intérieures et dont les conversations pseudo communicantes ne sont que des taupinières disséminées par-ci par-là dans le monde social de surface.
Cela est assez pitoyable, mais aussi tout à fait pardonnable. En effet je ne connais aucune école assurant l’apprentissage au non-savoir. Je crains même que le non-savoir soit régulièrement réprimandé. Notre culture a bien développé les outils permettant d’accéder à cette si précieuse substance intellectuelle qu’est le savoir… mais elle en a oublié une autre toute aussi précieuse : la capacité d’ouverture d’esprit, celle qui conduit à accepter de ne pas savoir.
Source de compétence
Le non-savoir, source de compétence ? Comment est-ce possible ? On peut même évoquer le corollaire : le savoir peut être source d’incompétence.
Le problème, c’est quand le savoir ferme l’esprit. Je vois régulièrement cela quand je forme des soignants : Quand ils disposent d’un dossier qui leur permet de connaître un malade, ils oublient souvent de l’écouter.
N’imaginez surtout pas qu’il s’agisse là de soignants indifférents ou négligents. La caricature serait maladroite et déplacée. Non je parle de personnel dévouéet souhaitant faire pour le mieux. Vous trouvez cela exagéré ? Notez cet exemple :
Une personne souffre d’un cancer des os avec métastases. Cette maladie grave amène l’équipe soignante à être particulièrement attentionnée pour cette patiente. Celle-ci se plaint d’une douleur importante à la cuisse, au niveau du fémur. « Sachant » sa pathologie, le médecin répond à cette douleur par un antalgique adapté… Or un autre médecin, peut être « sachant moins a priori« , ayant moins de certitudes, découvre en l’examinant avec plus de précisions que sa douleur ne vient pas directement de son cancer des os…mais d’une fracture. Le soin chirurgical adapté à cette fracture a fait cessé la douleur… qui résistait aux antalgiques. Ici le savoir a produit de l’incompétence alors que l’acceptation de ne pas savoir a produit de la compétence.
Dès l’école primaire
Nous avons cependant été sensibilisé tout au long de notre scolarité à cette qualité du non-savoir. Oh ! Cela ne s’est peut-être pas vu, car noyé dans la glorification de l’intellect, dans la récompense de la tête bien pleine.
Vous souvenez-vous combien de fois l’enseignant vous a répété : « avant de chercher la solution à ton problème de math, lis l’énoncé« , sous entendu « accepte de ne pas connaître l’énoncé avant de l’avoir lu ».
Même chose en français : « Avant de vous lancer dans une dissertation, lisez bien le sujet ». Combien de fois la note fut décevante à cause d’un « hors sujet ». Accepter de « ne pas savoir » avant d’avoir lu attentivement, nous aurait épargné ces déboires.
Cet aspect embryonnaire du non-savoir ne nous a pas permis d’en saisir toute l’importance. Il ne fait aucun doute qu’il n’a jamais été glorifié comme source de compétence à un quelconque moment de nos études… ou alors ce fut discret !
D’autant plus discret que quand l’élève a de mauvaises notes, l’enseignant, lui, « sait » pourquoi : « travail insuffisant », « peut mieux faire », « trop dissipé »… mais jamais ce ne peut être pour une autre raison ! Ce ne peut être parce qu’il y a des bases manquantes, parce qu’un cours est mal adapté, parce qu’il y a des problèmes familiaux, parce que l’élève est mal dans sa peau ou parce qu’il vit une difficulté relationnelle avec ses copains de classe …etc.
Accepter de ne pas savoir pour mieux communiquer
Hésitations à ne pas savoir
La communication est certainement le domaine où l’aptitude à ne pas savoir est basique pour être compétent. Naturellement il y a tout de même des choses à savoir. Mais là nous sommes généralement bien fournis. C’est du côté de l’aptitude à ne pas savoir que la carence est monumentale.
L’homme rêve de savoir ce que pense l’autre sans passer par lui. D’où le succès des méthodes « divinatoires-scientifiques » telles que la graphologie ou la morphopsychologie. Même dans un fonctionnement populaire combien de conversations tournent au quiproquo simplement parce que ce qui est dit est interprété plutôt qu’entendu. Les mots incompris sont même inconsciemment remplacés par d’autres pour donner du sens à ce qui n’en a pas. Des sketchs de caméra caché nous ont même régalé à la télévision sur de telles situations.
La réalité est que l’être humain n’aime pas ne pas savoir. Il ne supporte pas ce vide de l’esprit.
Il n’assume pas de devoir passer par l’autre pour le comprendre. Même quand des enseignements en communication nous parlent d’empathie, l’idée est d’entendre l’autre pour pouvoir se mettre à sa place afin de mieux le comprendre!
C’est un piège, car on ne peut jamais se mettre à la place de l’autre. Se mettre à sa place revient à ne contempler que notre propre imaginaire et à ne plus voir notre interlocuteur. Pour plus de détails, vous pouvez lire sur ce site l’article de novembre 2000 « Le piège de l’empathie«
Pour bien communiquer, il est fondamental d’accepter de ne pas savoir à la place de l’autre. Il ne s’agit pas de « ne rien savoir du tout » ! Il s’agit juste de ne pas savoir à la place de l’autre. C’est la base pour entendre, comprendre et accueillir son propos. C’est la base aussi pour poser de vraies questions dont les réponses seront validées par des messages de gratitude. Ceci est encore plus important pour poser une succession de questions qui conduiront à une validation de cohérence du propos initial. Ceci est donc fondamental pour que les cinq pôles de validation de la communication soient réels. Pour plus de détails, si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez lire le dossier sur ce site « Conséquences de l’état communicant – Les cinq points de validation »
Non savoir et communication professionnelle
Le non savoir dans le management
Il arrive qu’un cadre ait un membre de son équipe qui refuse de faire un travail ou persiste à le faire de façon insatisfaisante. Pour bien manager, le cadre doit accepter de ne pas savoir à la place de son collaborateur ce qui motive ce refus ou cette négligence. Pour gérer cette situation la phase de non-savoir est très importante. Or souvent les idées toutes faites jaillissent spontanément à l’esprit : « encore un qui a mauvais caractère », ou « il m’en veut », ou « il ne supporte pas l’autorité », ou « il n’a pas du comprendre l’importance de ce que je lui demande » Chacune de ces suppositions conduit presque toujours à une analyse fausse de la situation et donc à des solutions erronées.
Par exemple un cadre d’un service administratif a un collaborateur qui ne tient pas à jour des saisies de données statistiques. Ces statistiques concernent la sécurité routière. Le cadre pense que peut être l’employé trouve la tâche ennuyeuse et qu’il n’en a pas cerné l’importance. Il la lui explicite alors plus clairement : « Je sais que ces saisies ne sont pas très palpitantes, mais vous savez, ces données permettent d’accélérer les dossiers pour les personnes dont le permis à été suspendu et surtout de leur fournir une formation visant à les rendre moins dangereux pour les autres sur la route« .
L’explication est excellente et même bien formulée en mettant l’attention sur les bénéficiaires : ceux qui n’auront pas à subir les fautes des chauffards. Sauf que le collaborateur répond : « De toute façon ça ne sert à rien« . Gare ici à la tentation de lui expliquer de nouveau pourquoi, au contraire, c’est très important. Ce que dit le collaborateur semble faux ? Vous ne comprenez pas pourquoi il persiste dans son erreur apparente ? Alors acceptez de ne pas le savoir à sa place et soyez simple… demandez lui : « Qu’est-ce qui, pour vous, rend cela si inutile ? » …si possible avec un non verbal montrant que vous lui accordez qu’il a certainement une bonne raison, que vous ne la connaissez pas, mais que s’il le veut bien, il peut vous la révéler. Ce non verbal sera généré automatiquement par le fait que vous pensez vraiment ce que vous dites !
Dans cet exemple il répond alors : « L’année dernière j’ai perdu mon meilleur ami dans un accident de la route. Ces statistiques ne servent à rien » Il prononce cela avec un ton de colère et de chagrin mêlés.
Nous comprenons alors pourquoi les explications ne servaient à rien. Avant de se faire expliquer quoi que ce soit, il a besoin que l’on prenne en compte ce qu’il ressent. Cela peut s’exprimer avec une phrase du genre « Si vous avez vécu cela, je comprends parfaitement que ce travail vous soit insupportable« . On peut continuer éventuellement en lui demandant « Le manque de cet ami est trop douloureux ? » Par son côté affirmatif, cette phrase montre qu’on a compris. Mais par le point d’interrogation qui la termine, elle lui permet de se positionner par un « oui ». Ce « oui » nous donne l’opportunité d’une nouvelle validation du genre « Je comprends d’autant mieux ».
C’est à partir de là, et seulement à partir de là, que des explications peuvent trouver leur place pour lui montrer que justement son travail contribue à éviter cela. Sans la phase de non savoir, la compétence du cadre au management est inopérante dans cette situation.
Non savoir dans les services de santé
Une personne âgée est hospitalisée. Elle est peu expressive. Quand une infirmière vient lui prendre la tension la vieille dame recule son bras. L’infirmière imaginant une cause à ce geste lui reprend la main (doucement) et lui dit avec un ton l’invitant à ne pas s’inquiéter « Je vais faire vite« .
Mais la dame est toujours mal. Même dit doucement, le propos de l’infirmière suppose que le problème était que ça dure longtemps. Celle-ci ne se place pas en situation de non savoir. Elle pense trop à la place de sa patiente.
Imaginons que cette vielle dame ait peur car elle ne supporte pas qu’on la touche et qu’elle ne supporte pas qu’on la touche car elle a été violée dans son enfance… il y a mieux à faire que de lui dire « je vais faire vite »… cette phrase peut même malencontreusement aggraver sa peur si c’est, ce qu’autrefois, lui a aussi dit l’auteur du méfait.
Même prononcée avec douceur, la phrase de l’infirmière reste une maladresse (mais c’était quand même mieux de l’avoir dite doucement plutôt que brutalement !)
Cette maladresse vient simplement du fait qu’elle n’a pas su ne pas savoir. Elle a substitué ce qu’elle imaginait à ce qu’elle ne savait pas. Elle est restée ainsi dans l’ignorance du vrai problème. Elle a alors mis en œuvre une solution inadaptée. Ici encore la capacité à ne pas savoir aurait été source de compétence.
Dernièrement, une émission télévisée sur les urgences hospitalières, nous montrait une dame d’un certain âge, n’ayant peut être pas toute sa tête, peut être un peu alcoolisée, être invitée à s’asseoir. Celle-ci répond « je ne peux pas m’asseoir! » Elle s’entend rétorquer « Mais si, il faut vous asseoir, on va s’occuper de vous!« . La dame tente d’ajouter « j’ai un homme de 72 ans à la maison! » alors que le soignant s’éloigne. Mais comme cette dame n’est vraiment pas coopérante, un médecin arrive, tente de l’empêcher de partir en lui tenant le poignet en lui disant « Il faut que vous restiez… c’est pour votre bien! ». La situation ne s’arrangeant pas, deux agents de sécurité viennent prêter main forte.
Ici encore, le soignant ne se met pas en situation de ne pas savoir. Il pense que cette dame n’a pas compris que c’est pour son bien. Alors il le lui explique. Mais cela produit l’effet inverse de l’effet attendu.
Acceptant de ne pas savoir, il aurait donné plus d’attention à cette dame et aurait remarqué simplement qu’elle a plus besoin de recevoir une écoute que des explications. Cette écoute aurait évité la montée de violence, économisé du temps ainsi que l’intervention de quatre personnes (2 soignants et 2 agents de sécurité). Quand on a peu de temps et peu de personnel cela semblerait plus judicieux.
A la décharge de ces soignants, il faut reconnaître que leur travail est très difficile et s’accomplit souvent dans des conditions mal adaptées. Mais cela ne fait qu’une raison de plus pour faire équipe avec le patient plutôt que de passer son temps à essayer de le convaincre. Et faire équipe avec lui c’est d’abord accepter de ne pas savoir à sa place. C’est ensuite accorder de la valeur à ce qu’il pense pour enfin pouvoir lui donner l’explication dont il a besoin.
La difficulté des soignants, c’est le dossier de soin. Quand celui-ci est bien fourni, le soignant croit connaître le malade et oublie de l’entendre. Naturellement il ne faut pas enlever ce savoir que représente le dossier. Il faut simplement accepter qu’il ne donne qu’une partie des éléments. Cela semble évident ? Mais la difficulté à accepter de ne pas savoir fait que le dossier prend toute la place. C’est comme cela que dans l’exemple cité plus haut, sur un point médical (même pas psychologique) un médecin attribue la douleur dont se plaint un patient à son cancer des os, sans voir la fracture qui cause cette douleur.
Source de compétence en psychothérapie
Déjà basique en communication, le non-savoir est fondamental en psy. Or là aussi en psychothérapie, en psychologie et en psychanalyse, la tentation est de s’appuyer sur le savoir. Naturellement, le savoir a ici aussi une grande importance. Mais les professionnels sont généralement bien pourvus côté « savoir »… même si celui-ci reste sans cesse perfectible.
Par contre, quand la capacité à « ne pas savoir » manque, la tentation de s’appuyer sur des théories pour interpréter, conduit à des maladresses.
Par exemple une soignante vit un stress immense depuis qu’elle a assisté à la scène suivante : Une femme dit à son jeune époux hospitalisé et en fin de vie : « Mon Chéri, tu peux partir en paix… je me débrouillerai » Dans un groupe de régulation, la soignante exprime sa propre douleur au psy qui aide l’équipe. Elle s’entend répondre par celui-ci qu’elle est trop proche du patient et qu’elle a pris la place de l’épouse (si Freud est dans les parages… la connotation est des plus ambiguës)
Tout serait pour le mieux si cette explication avait apaisé la soignante en réelle souffrance. Mais il n’en était rien. Le psy n’avait pas su « ne pas savoir ». Il avait substitué à ce non savoir une interprétation basée sur ce qu’il a appris.
Sachant ne pas savoir il aurait pu demander à cette soignante « Cela vous été insupportable d’entendre cette femme dire ça à son mari ? » Elle aurait répondu « Oui » Il aurait continué par » insupportable de quelle manière ? » Elle aurait répondu « j’ai eu l’impression qu’elle l’abandonnait » Il aurait pu continuer par « L’abandon est quelque chose qui vous touche beaucoup ? » Elle aurait répondu « Oui. Mes parents m’ont abandonnée quand j’étais enfant ! « . Là elle se sent comprise et, en plus, comprend la vraie raison de ce qui l’a affectée dans cette situation du couple face à la fin de vie.
Cela peut sembler simple ? Ce n’est simple qu’avec l’acceptation de ne pas savoir à la place de l’autre. Cette situation n’est pas inventée car j’ai effectivement eu cette soignante en formation et les propos que je viens de citer sont exactement ceux que nous avons eus. En acceptant de ne pas savoir à la place de l’autre et de ne pas interpréter, nous pouvons parfois en quelques questions arriver à la vraie raison. Dans cet exemple il aura fallu trois questions !
Naturellement, pour qu’il y ait thérapie, il faut quelque chose de plus. Une thérapie se divise en deux étapes :
Une première étape dans laquelle on localise la zone de vie blessée (qu’elle soit actuelle, qu’elle vienne de l’enfance, du prénatal ou du transgénérationnel) C’est ce que je viens de décrire dans l’exemple ci-dessus.
Une deuxième étape , dans laquelle on apporte l’attention et le soin réparateur sur ce qui a été localisé.
Sans une qualité de non-savoir de la part du thérapeute, la première étape échoue car les bonnes pistes ne sont pas identifiées. Naturellement il en découle que la deuxième ne peut se faire. Mais même si la première est correcte, la deuxième peut aussi échouer si le thérapeute interprète que le patient doit se débarrasser de « tout ça » alors que celui-ci cherche inconsciemment une réhabilitation de « tout ça » !
Il y aurait encore beaucoup à dire sur la thérapie. Mais il serait hors sujet dans cet article d’aller plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le dossier thérapie de ce site.
L’absence de capacité à « ne pas savoir » conduit le thérapeute à interpréter ce que dit le patient. Il se produit alors une sorte de contre transfert inattendu : le thérapeute réagit par rapport à ce qu’il croit et non par rapport à ce qui s’exprime alors il « plaque » cela sur le patient.
De façon habituelle, Le transfert c’est quand le patient attribue inconsciemment au thérapeute une attitude qu’un membre de son entourage a eu avec lui et qui avait généré de la douleur ou du manque. Cela engendre de sa part une réaction envers le thérapeute. C’est un outil majeur utilisé dans de nombreuses thérapies de type analytique. Le patient y rejoue ainsi la zone traumatique de sa vie et, accompagné par le thérapeute, s’en libère .
Le contre transfert, c’est quand le thérapeute, malencontreusement, prend cela au pied de la lettre et croit que ce message lui est adressé personnellement. Si le thérapeute a lui-même trop de zones de blessures restées en suspend, il risque alors inconsciemment d’attribuer les attitudes de son propre entourage passé à son patient. Le thérapeute réagit alors par rapport à son histoire personnelle et cesse d’accompagner son patient sur l’histoire qui est la sienne. C’est ce qui justifie une supervision du thérapeute par un confrère qui va l’aider à recentrer cela.
Quand le thérapeute s’appuie sur son savoir et en vient à interpréter ce que lui dit son patient… même si c’est pour l’aider, il ne fait que (contre)transférer sa propre pensée sur celui-ci… Il s’éloigne alors de ce qui fait la qualité d’une thérapie.
Même s’il ne transfère pas son histoire personnelle, il transfère son savoir sur le patient comme on transfèrerait un motif sur un tee shirt avec un fer à repasser.
A ce jeu de décalcomanie, le patient à qui on pose une interprétation risque de se trouver dépossédé du sens réel que son histoire a pour lui… il peut alors se perdre dans un monde qui n’est pas le sien et tenter en vain de recoller des morceaux qui ne lui appartiennent pas. Cela rend la thérapie au mieux inefficace… au pire dangereuse…
Unité de valeur « non-savoir »
Puisque le non-savoir fait défaut, amusons-nous à imaginer une unité de valeur qu’on ajouterait, au moins, à toutes les études concernant les métiers de communication et les métiers de soin psychologique.
Nous aurions une sorte d’université du non-savoir venant apporter l’indispensable complément à ce qui est déjà enseigné. Naturellement l’aptitude à ne pas savoir ne remet pas en cause le savoir. C’est juste quelque chose à y ajouter. C’est quelque chose qui s’ajoute et non quelque chose qui remplace.
Un contrôle de connaissances par rapport à une aptitude à ne pas savoir semblerait sans doute paradoxal. Ce serait une sorte de pied de nez au « tout intellectuel ». Mais ce serait aussi une belle ouverture vers les nuances d’étique manquantes.
Nous évoquons souvent le respect de la différence, la tolérance, la générosité… mais sans l’aptitude à ne pas savoir, ces merveilleuses idées ne sont que des idéologies (aussi généreuses soient-elle).
Dans un service de soins un patient dont on a amputé la jambe dit « Où est ma jambe, qu’en avez vous fait? » avec un non verbal empli de tristesse et d’angoisse… On trouve alors une équipe de soignants investie dans le fait de l’apaiser psychologiquement. Croyant que l’angoisse de ce patient est un futur inacceptable l’un d’entre eux, tente de le rassurer en lui montrant qu’il a gardé un genou en bon état qui lui permettra de bien maintenir sa prothèse… que son kiné a lui-même eu une telle amputation (c’était le cas) et mène une vie normale aujourd’hui… etc. Mais personne n’entend qu’il parle de sa jambe comme d’un membre de sa famille dont il doit faire le deuil… et qu’un deuil se fait mieux quand on se rapproche que quand on oublie. Je devrai sans doute un jour vous proposer un article sur ce thème.
Mais nous n’avons pas forcément besoin de circonstances aussi extrêmes pour expérimenter le non-savoir et tester son efficacité. L’entraînement peut avoir lieu dans les moments insignifiants de la vie.
Ainsi quand quelqu’un vous tient un propos avec lequel vous n’êtes pas d’accord, amusez vous à remarquez votre réaction. Votre tendance spontanéeest-elle d’essayer de comprendre votre interlocuteur, c’est à dire de lui accorder que ce qu’il dit a un fondement pertinent pour lui, et de lui permettre de vous le révéler. Votre tendance est-elle plutôt de le contredire gentiment, c’est à dire de chercher à le convaincre que votre point de vue est mieux fondé que le sien ou au moins plus urgent à exprimer. Cela concerne des situations aussi anodines qu’un avis sur une émission de télé ou une conversation de repas de famille.
En attendant que l’éducation nationale et universitaire s’occupe d’enseigner l’aptitude au non-savoir, nous pouvons nous contenter de ces petits riens du quotidien qui font de chaque instant d’échange un merveilleux champs d’investigation.
Cette aptitude au non-savoir concerne finalement un esprit de rigueur scientifique où ce qui n’est pas démontré n’est ni vrai ni faux. Il en résulte une attitude ni pour ni contre, mais où l’on reste ouvert à toutes les éventualités tant que les démonstrations ne sont pas faites. L’aptitude au non-savoir permet une progression plus efficace et rapide des connaissances.
Passer de l’écoute « prédation » à l’écoute humaine
La tendance est d’entendre les paroles d’autrui comme un animal entendrait des bruits suspects émanant d’un éventuel prédateur. Quand ce n’est pas le cas c’est souvent pour profiter de l’information comme un animal profiterait de sa proie. Il y s’agit d’un intérêt pour s’en défendre ou pour en tirer un avantage… rarement pour une réelle rencontre de l’autre !
Vous avez déjà vu comme un chat ou un chien bouge ses oreilles au moindre bruit suspect. Évidemment les animaux sauvages aussi. Ce réflexe de méfiance, de prudence habitant « l’ouie instinctive » pousse peut-être l’humain à manifester une écoute un peu paranoïaque. Méfiance car tout est danger ! ou sinon, à l’assaut car tout est profit.
Il en résulte que la plupart des échanges se font plus sur un mode animal que sur un mode humain. Ce qui occulte cette animalité de l’écoute c’est que, si l’animal en retour de ce qu’il entend brandit ses griffes ou ses crocs, l’homme brandit plutôt ses capacités intellectuelles et son savoir. Mais en fait le réflexe est le même. L’aspect intellectuellement élaboré de ce retour en masque la profonde animalité.
Pour que l’écoute devienne vraiment humaine, il lui faut plus que de l’intellect. L’utilisation de l’intellect n’étant ici qu’une version évoluée des réflexes animaux. Pour devenir vraiment humaine, l’écoute nécessite absolument cette aptitude à ne pas savoir. Elle nécessite aussi cette confiance en le fait que ce que dit l’interlocuteur a du sens et du fondement à ses yeux… Il est souhaitable d’être prêt à entendre ce sens et ce fondement sans se sentir en danger… sans sentir une menace peser sur notre propre point de vue.
Pour cela nous devons d’abord développer un peu plus d’affirmation de soi. C’est à dire un peu plus d’accueil de soi. C’est à dire un peu plus d’accueil de celui que nous sommes, de tous ceux que nous avons étés et de tous ceux dont nous sommes issus.
Or notre culture nous a plus habitué au fait que ce qui nous habite est mauvais et qu’il faut apprendre à être fort pour le vaincre. Certains aspects de la psychologie se sont aussi laissés piéger dans ce concept où même l’inconscient est considéré à tort comme quelque chose renfermant du mauvais. De cette façon, l’écoute de soi est également atteinte par le réflexe de défense. Il est souhaitable que la psychologie veille à continuer à s’humaniser en faisant évoluer l’écoute de soi d’une écoute animale (paranoïaque) vers une écoute humaine (accueillante).
Le savoir semble distinguer l’homme de l’animal… naturellement!.
Mais c’est le complément que représente l’ « aptitude au non-savoir » qui le positionnera vraiment en première position.
Cette aptitude montrera qu’il peut échanger avec ses congénères libre de ses réflexes ancestraux de prédation ou de peur des prédateurs.
S’ajoutant à la connaissance, l’ « aptitude au non-savoir » est ce qui marque le passage de l’animal à l’humain.
La compétence la plus importante qu’elle permet
est une compétence à plus d’humanitéThierry TOURNEBISE
L’article sur René Descartes, publié en décembre 2006 complète bien ce document sur le non savoir
Étiquettes : Maïeusthésie, Thierry Tournebise
Leave a comment